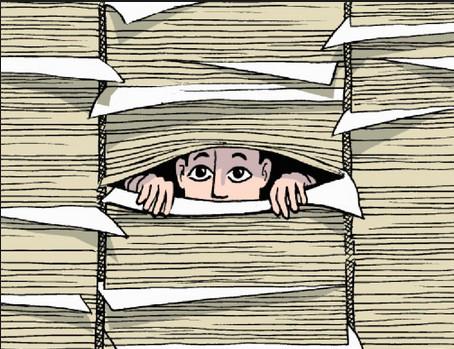
Les scandales financiers et sociaux accréditent l'idée que les patrons ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Cette thèse, même si elle n'est pas vraie pour beaucoup de petits patrons, correspond à une vérité statistique qui permet d'expliquer les ressorts du capitalisme.
Ce qui est vrai pour les décideurs économiques est également vrai pour les décideurs politiques et institutionnels. James M. Buchanan, prix Nobel d'économie en 1986, a montré que la maximisation des intérêts personnels explique, de façon statistique, les comportements de tous les décideurs, et pas seulement le comportement des décideurs économiques. A la différence du capitaliste, l'intérêt personnel de l'acteur public n'est pas d'accumuler un capital, mais de se rendre indispensable. Dans le privé, réussir, c'est faire fortune. En politique, c'est se faire réélire ou obtenir des mandats plus importants. Pour un haut fonctionnaire ou le chef d'un service public, c'est rendre son administration incontournable, quel que soit le service apporté.
Buchanan a analysé le fonctionnement réel des services publics. On est bien loin de l'État protecteur, juste et impartial, représentant le bien commun. Le décalage entre l'idéal et la réalité est comparable au décalage qui existe dans le monde économique entre le fonctionnement réel du capitalisme et la théorie libérale. La redistribution des richesses est largement conditionnée par l'égoïsme des décideurs.
Le poids de la bureaucratie est devenu insoutenable et les réactions de refus se multiplient. Dans les entreprises, travail au noir, délocalisations, ou refus de se soumettre à des déclarations légales se sont banalisés. Chez les plus défavorisés, plus d'un million de foyers qui pourraient accéder au RSA n'en font même pas la demande. Les procédures sont ressenties comme des entraves. A chaque nouvelle réforme, qui part souvent d'une bonne intention, la tutelle administrative s'alourdit. Les premiers concernés sont largués. Le chef d'entreprise doit faire appel à un expert-comptable pour comprendre et réclamer ses droits. Le jeune en galère est tributaire des calculs et des conseils de l'assistante sociale. Le citoyen se perd dans des "droits" qui sont théoriquement les siens, mais qui, du fait de leur complexité, ne lui appartiennent plus.
Les mouvements sociaux du XXe siècle revendiquaient un salaire décent et des conditions de travail satisfaisantes. Ces revendications étaient vues comme un droit élémentaire, simple à comprendre. On savait qui était le propriétaire de l'entreprise.
Les Bonnets Rouges du XXIème siècle élargissent à la sphère administrative les revendications populaires, jusque-là limitées à la sphère économique. Ce n'est pas étonnant. Le chômage de masse est venu perturber les droits liés au travail. Pour avoir des droits, la condition préalable est d'avoir un statut social que l'on peut assumer soi-même, sans être sous la tutelle de ceux qui le comprennent ou le contrôlent. Avoir un statut ou obtenir des droits ne dépend pas d'un patron bien défini quand on est chômeur, intérimaire, salarié d'une entreprise en difficulté, paysan, autoentrepreneur, travailleur indépendant, artisan, salarié de certaines associations, coopératives ou filiales lointaines de multinationales. Nous sommes nombreux dans ces catégories. La machine administrative peut bloquer nos droits, les rendre incompréhensibles, ou compliquer la façon de les obtenir.
Les décideurs publics, élus ou non, se sont assuré une place indispensable, en multipliant les procédures et les contraintes administratives. Ils se sont rendu incontournables, non par les problèmes qu'ils résolvent, mais en imposant une manière bureaucratique de les poser. Ils font partie du problème. Il n'est pas sûr qu'ils fassent partie de la solution.
Jean Pierre LE MAT